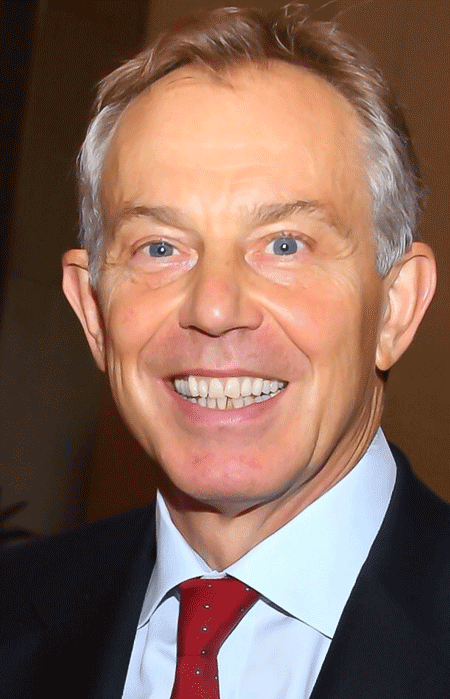
Lorsque vous avez été élu membre du Parlement en 1993 et que vous avez découvert le terrain politique à Sedgefield, qu’est-ce qui vous a le plus frappé ?
Ce qui était extraordinaire, pour moi, chez ces gens du nord-est de l’Angleterre, c’est qu’ils étaient « normaux ». J’avais été au parti travailliste et Londres, très à gauche à ce moment-là, j’étais pris dans une sorte de folie. J’allais aux réunions des militants du parti en me demandant « Est-ce moi ou eux ?… parce que quelque chose ne tourne pas rond ici. » Aussi, quand je suis revenu et que j’ai vu les gens du nord, ils étaient juste terre à terre, très sensés et je retrouvai un peu de ma foi dans la capacité du parti travailliste à sortir de l’opposition et à revenir au gouvernement. Vous savez, la circonscription était composée de vieilles communautés minières. Or les mines avaient fermé, il n’y avait plus de travail et l’industrie traditionnelle avait disparu. Cette région était en transition totale. Les gens devaient accepter l’idée que les emplois de leurs pères et de leurs grand-pères n’étaient plus des emplois d’avenir. C’était une grande leçon pour moi parce que je me souviens qu’à l’époque, pour la première fois nous avons décidé, dans le nord-est, d’accueillir des investissements japonais, des voitures Nissan. Cela fut extrêmement controversé, on disait que nous trahissions notre patrimoine en les accueillant. Ensuite, quand ils commencèrent à travailler pour les Japonais, les gens réagirent positivement. C’était mieux de travailler dans une usine automobile que dans une mine. Ce fut pour moi une grande leçon sur le changement politique et les résistances qui l’accompagnent : si le changement est juste, ils ne veulent plus jamais revenir en arrière. Cette leçon me suivit dans ma vie politique.Pouvez-vous nous parler, M. le Premier Ministre, du rôle joué par votre femme tout au long de votre carrière politique ? Nous savons par exemple qu’Hillary a eu de l’influence sur Bill Clinton, que la Reine Rania a de l’influence sur le Roi Abdallah, Madame Mubarak sur Hosni Mubarak…
Elle a été une force considérable pour moi, c’est certain. En fait, je n’aurais jamais accompli autant en politique sans elle. Cherie a toujours su me donner de la force dans les moments de doute et d’hésitation. Avant que j’entre au Parlement, à l’âge de trente ans, je pensais quasiment n’avoir aucune chance. Le parti travailliste à ce moment-là était très à gauche, j’étais très modéré, par conséquent, cela semblait sans espoir. Elle me disait, pourtant « tu dois t’accrocher, tu as une vision, peu importe le temps que cela prendra, tu dois voir au-delà. » Honnêtement, plus qu’une conseillère politique, elle a vraiment été une force morale et personnelle.
En 1997, votre campagne était focalisée sur des questions politiques majeures comme l’éducation, la protection sociale et les valeurs individuelles. Diriez-vous que votre foi religieuse a inspiré vos idées politiques par certains aspects ?
Je pense que si vous avez la foi, il ne s’agit pas d’une chose anodine ou périphérique, c’est fondamental pour vous. D’un autre côté, je n’allais pas faire une prière et revenir avec ma politique éducative. Vous savez, on doit être prudent avec cela. Mais je pense que le parti travailliste et les progressistes devraient appliquer des valeurs de justice sociale, de travail avec et pour autrui mais dans un monde moderne.
Le lendemain de votre élection, vous avez rencontré sa majesté la Reine Elizabeth II. Comment vous êtes-vous senti alors ? Ce n’est pas toujours facile de rencontrer la Reine, je suppose…
Non, j’étais très nerveux à l’idée de la rencontrer pour la première fois. Il y a toute une cérémonie. Vous devez entrer, vous agenouiller et êtes supposé effleurer de vos lèvres la main de la Reine. Malheureusement, juste quand je suis arrivé près d’elle, j’ai trébuché légèrement et j’ai embrassé sa main plus chaleureusement qu’il n’était approprié. J’étais très impressionné et elle m’a dit que c’était très bien que je sois maintenant Premier Ministre. Son premier Premier Ministre avait été Winston Churchill, c’était avant ma naissance… Alors je me suis senti tout petit.
Mais en fait elle était très aimable et me mit à l’aise.
Est-elle intimidante ?
Oui, elle est très intimidante parce qu’elle est très humaine, très perspicace dans sa lecture des situations. Elle a une grande expérience, je veux dire qu’elle a tout vu en matière de Premier ministre !
Vous êtes l’unique Premier ministre anglais à avoir arrêté un conflit vieux de plusieurs siècles, celui de l’Irlande du Nord. Considérez-vous qu’il s’agit de votre plus grande réussite ?
Je ne suis pas certain de la façon dont on ait compris les événements d’Irlande du Nord ; c’était une chose terrible pour nous. Vous savez, j’ai grandi avec les troubles en Irlande. Durant des décennies, on apprenait le matin au réveil qu’une bombe avait explosé et que des gens avaient été blessés ou tués. C’était une telle tragédie pour les populations d’Irlande du Nord et pour l’ensemble de l’Archipel, qu’il a fallu travailler dur et également que les gens décident enfin d’évoluer, de vivre avec leur temps. Fondamentalement, c’était une querelle « démodée », Catholiques contre Protestants, alors que nous nous engagions dans le XXIème siècle ! Aussi, bien que ce fut difficile, j’étais presque optimiste et je savais que c’était réalisable. Il y eut, tout le long de la route, des hauts et des bas, mais nous y sommes parvenus.
J’imagine que vous êtes très fier de cela…
Oui, j’en suis fier et je suis fier aussi des gens qui ont accompli cela et fier également de la population d’Irlande du Nord qui a surmonté des décennies et même des siècles de difficultés, de sectarisme et de division. L’important en politique est de dire que les choses peuvent changer. Il y a le progrès, il y a l’espoir. L’humanité fait des pas en avant même si elle régresse également.
Vous avez été le premier Chef d’Etat appelé par Georges Bush le 11 septembre. Aviez-vous une vision commune avec lui de la lutte contre le terrorisme, déjà à ce moment-là ?
J’avais la conviction après le 11 septembre que la totalité des affaires étrangères était bouleversée, que nous étions confrontés à un terrorisme mondial et que la position de la Grande-Bretagne devait être aux côtés de l’Amérique. Ce fut mon action la plus controversée lorsque j’étais à mon poste, mais j’avais cette conviction alors et je dois dire que je l’ai toujours. Je n’ai jamais regardé le 11 septembre comme une attaque contre l’Amérique mais comme une attaque contre nous, notre façon de vivre, nos valeurs, notre système.
L’opinion publique anglaise, comme l’opinion publique française de l’époque était contre une intervention militaire en Irak, cependant vous avez décidé d’y envoyer les troupes anglaises. Quelles étaient vos motivations ?
Je pense qu’il y a beaucoup de situations dans lesquelles la politique signifie faire des compromis. Parfois vous pouvez penser, même si c’est réellement votre volonté, que cela va être très difficile et qu’il y a lieu alors de procéder autrement. Je ne dis pas que dans ma propre carrière politique et dans la réforme du service de la santé, de l’éducation ou des retraites, dans la façon dont nous avons géré tel ou tel aspect de l’économie, j’ai fait ces compromis.
Parfois j’ai estimé que c’était d’une telle importance, qu’il valait mieux agir de la manière dont j’étais convaincu et en payer les conséquences politiques plutôt que de choisir le compromis. Je voulais surtout ne pas faire ce que je pensais être le mauvais choix. Au moment où je prenais cette décision, je n’ignorais pas que ce serait difficile mais je croyais simplement que c’était notre devoir et que, si nécessaire, je devais être préparé à quitter mon poste.
Quand Londres fut frappé par une attaque terroriste le 7 juillet 2005, avez-vous eu le sentiment à ce moment précis de payer le prix, comme le dirent certains, de votre alliance avec le Président Bush ?
Eh bien, je pense que si vous tenez tête à vos ennemis et si vous les défiez, ils vont essayer de vous combattre mais c’est mieux que de leur céder. Par conséquent, on peut se disputer, vous savez, pour savoir si nous faisons ou non de notre pays une cible, en ayant une alliance avec les Etats-Unis mais vous ne pouvez pas déterminer votre politique sur les bases de la terreur. Je crois également qu’il doit y avoir une explication si l’Allemagne, la France, l’Espagne sont confrontées à une menace aujourd’hui, même après que cette dernière a retiré ses troupes d’Irak… À vrai dire, si ce n’est pas l’Irak, ce sera l’Afghanistan. Si ce n’est pas l’Irak et l’Afghanistan, ce sera alors une alliance avec un pays arabe. Ou le Cachemire, la Tchétchénie… Nous ne vaincrons pas cette menace sans avoir foi en nos idées, nos méthodes et sans nous préparer si nécessaire dans le domaine militaire, pour défendre ce en quoi nous croyons.
Vous étiez supposé finir votre troisième mandat en mai 2009, vous avez démissionné en juin 2007, pourquoi ce départ anticipé ?
Il est très difficile de répondre à cette question. Le premier mandat, c’est bien, le deuxième mandat, c’est bien… Quand vous entamez un troisième mandat, la seule chose que l’on veut savoir c’est quand vous allez le finir. J’ai pris l’initiative inhabituelle de dire que je ne disputerai pas une quatrième élection. C’est très difficile, dix ans, c’est vraiment long au poste de Premier Ministre. Face à une si grande responsabilité, au bout d’un moment, c’est bien de partir. Au cours des dernières années, en particulier dans mon programme de politique intérieure (je sais qu’il y avait un focus sur la politique internationale) nous avons appliqué de grandes réformes à notre constitution. Nous avons introduit le salaire minimum pour la première fois, il y a eu l’indépendance de la Banque d’Angleterre, la réforme massive du service de santé, de l’éducation, de l’aide sociale, les retraites, l’énergie, l’ordre public, l’immigration : nous avions un grand programme. Et je voulais rester pour mettre cela en place.
Monsieur le Premier Ministre, aujourd’hui vous vous impliquez dans le processus de paix au Moyen-Orient. À votre avis, quelles sont les solutions pour mettre fin à un conflit israélo-palestinien vieux de 60 ans ? Vous avez trente secondes.
D’accord, trente secondes. Vous voyez encore, c’est un conflit qui peut être résolu aujourd’hui parce que c’est essentiellement un conflit « démodé ». La vérité est que les Israéliens et les Palestiniens ont un intérêt commun à vivre ensemble. L’idée que nous devrions diviser les gens et faire la guerre à cause des religions n’est pas acceptable au XXIème siècle. Je veux dire que le grand combat dans la région est entre l’extrémisme et la modération. Et il est important de résoudre ce conflit pour montrer que la modération peut triompher parce qu’il y a beaucoup d’extrémistes qui veulent exploiter ce conflit. Je ressens une responsabilité personnelle en ce qui concerne cette région pour des raisons évidentes et je pense qu’en nous focalisant sur ce conflit, nous pouvons jouer un rôle et le résoudre. Je crois que c’est d’une importance fondamentale pour la paix future et la stabilité.
Propos recueillis
Christian Malard
