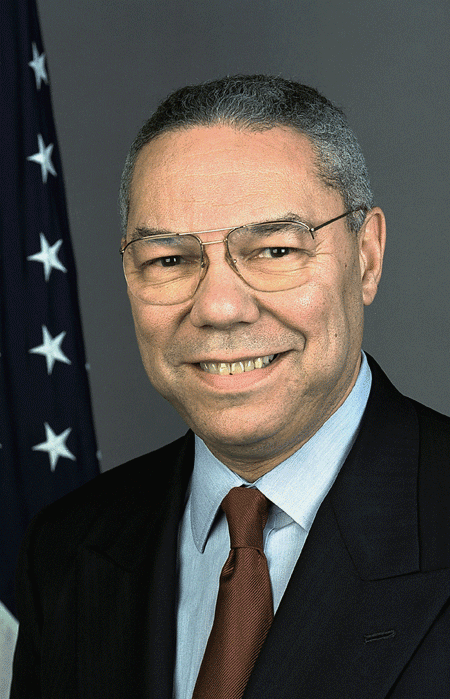
d’Etat des Etats-Unis
« Une guerre des idées…
Voilà ce qu’est la démocratie ! »
Vous définissez-vous comme un homme politique ou plutôt comme un soldat ?
Je serai toujours un soldat. Ma manière d’appréhender les problèmes, mon approche de la vie, ma perception des choses sont celles d’un soldat. Les gens se souviennent de moi comme Conseiller à la Sécurité nationale, ou en tant que chef d’Etat Major des armées, mais je suis à la base un officier d’infanterie. Et durant les 25, voire même les 30 premières années de ma vie d’adulte, ma carrière fut celle d’un Commandant de Brigade, puis d’un Commandant de Corps d’armée et enfin, celle d’un Commandant de toutes les Forces armées des Etats-Unis. Donc, je me considère bien comme un soldat. Et d’ailleurs, mes plus beaux souvenirs sont ceux qui datent de l’époque de mes commandements… Cela ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas un bon diplomate, ou que je n’aime pas la diplomatie. En revanche, je ne suis pas certain d’aimer le mot « politicien ». Bien sûr, j’ai fait de la politique et je m’y connais dans ce domaine, mais je ne me considère pas comme un homme politique.Vos parents étaient des immigrés Jamaïcains. Quelle fut leur influence sur votre destin et votre perception du monde ?
Mes parents furent un peu les étoiles du berger de mon existence. Tous deux étaient merveilleux. Ils étaient de petite taille (à peine 1m50), et étaient arrivés aux Etats-Unis faute d’opportunité économique en Jamaïque. Ils étaient venus plein d’espoirs et de rêves. Ils se sont rencontrés et se sont mariés ici, et ont eu deux enfants. Ce qu’ils ont cherché à nous transmettre, c’est que nous n’avions pas droit à l’échec. Peu leur importait dans quel domaine nous allions réussir, mais ils souhaitaient évidemment que cette réussite soit éclatante. En réalité, ce n’était pas primordial ! L’important, c’était que nous fassions mieux qu’eux, que nous ayons une vie agréable, que nous fondions une famille, et qu’ils soient fiers de nous.
On a l’impression que votre vie bascule le jour où vous rencontrez l’armée à l’université. Que s’est-il passé dans votre tête ?
C’était… vers la fin de l’été… au début de l’automne 1954. J’étais dans une école d’ingénieur depuis environ 6 mois et je n’y étais pas très heureux. Je n’avais pas de très bons résultats, ce n’était pas un domaine pour lequel j’étais très doué. J’ai alors remarqué ces cadets en uniforme qui défilaient autour du campus. Ils en imposaient tous ces hommes. J’ai décidé de les rejoindre. Ils m’ont donné un uniforme, que j’ai tout de suite apprécié. Je trouvais ça beau. Et j’aimais ces jeunes gens avec qui je partageais dorénavant mon temps, j’aimais la discipline et la structure de l’entraînement militaire. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que c’était un bon engagement. Suis-je pour autant tombé amoureux de l’armée, au point de me marier avec elle pour toujours ? Non, je ne crois pas ! Mais j’étais bon dans ce que je faisais, et lorsque le moment de passer mes examens est arrivé, l’armée m’a nommé officier. Mes parents m’ont alors indiqué : « Pour l’instant, tant que tu réussis, on est d’accord. Mais après, tu démissionnes et tu cherches un vrai travail »… Le problème, c’est que je n’ai jamais démissionné.
Comment avez-vous abordé vos premiers instants au Vietnam ?
Nous n’avions encore jamais vu de combats. Un jour, nous marchions à travers la jungle et descendions un sentier qui menait à une rivière, quand j’ai subitement entendu des coups de feu. Pour la première fois, je me suis retrouvé face au tir de l’ennemi, étourdi par le sifflement des balles. Il y a eu beaucoup de confusion, énormément de bruits, les soldats vietnamiens ont tiré pour riposter, et puis cela s’est arrêté tout d’un coup. On n’entendait plus que des cris, parce que quelqu’un était blessé. Je suis descendu à la rivière et là j’ai vu un homme qui avait été tué. Je l’ai regardé, puis nous l’avons soulevé et enveloppé dans un poncho. À cette époque, on devait transporter les morts avec nous, une journée, parfois deux ou trois, avant de pouvoir les évacuer par hélicoptère. Je me suis dit : « T’es pas dans un film. Ce n’est pas un jeu. Tout ça est réel, et cette balle aurait pu être pour toi ». Cela m’a fait réfléchir. Je me rappelle aussi de la nuit qui a suivi. J’étais allé dormir dans la jungle, sous les arbres, et je me suis dit : « Demain, nous allons revivre la même chose, et c’est ce que tu vas vivre pendant toute l’année que tu vas passer ici ». Cela faisait froid dans le dos, mais nous avons persévéré. Nous avons continué, mais on n’a jamais vu l’ennemi !
Finalement, 40 ans plus tard, avec le recul de l’Histoire, est ce que vous considérez que l’engagement américain au Vietnam était une erreur ou pas ?
C’est une guerre que nous avons perdue. Nous y sommes allés avec les meilleures intentions du monde : essayer d’aider un peuple à se protéger d’une insurrection et préserver la démocratie. Mais nous avons échoué. Pourquoi ? Pour des raisons politiques et peut-être militaires. Avons-nous envoyé suffisamment de troupes ? Avons-nous adopté la bonne stratégie vis-à-vis des Viet Congs ? Et d’ailleurs, pas seulement des Viet Congs, mais aussi de l’Armée nord-vietnamienne ? Nos amis français ont vécu la même crise avant nous… Avons-nous tiré les bonnes leçons de leur expérience ? Oui, c’est une guerre que nous avons perdue, et la leçon que nous avons retenue, sur le plan militaire en tout cas, a été la suivante : assurez-vous d’avoir une bonne compréhension de la situation politique et assurez-vous aussi d’avoir un objectif politique clair. Adoptez la bonne stratégie militaire et engagez suffisamment de troupes. Mettez en oeuvre ce que j’appelle une force décisive. On dit souvent que je parle de force « écrasante », mais c’est faux. Je parle de force « décisive » et c’est très différent. N’envoyez pas ce qui est nécessaire, mais plus que le nécessaire pour avoir une victoire franche. C’est comme cela que j’ai toujours essayé de mener mes opérations militaires.
Vous avez effectué un stage à la Maison Blanche en 1972…
Je n’avais pas trop envie de quitter à nouveau l’Armée pour reprendre des études, si bien que je n’étais pas demandeur. Mais mes supérieurs hiérarchiques m’ont ordonné de postuler à ce cursus très pointu. Et lorsque l’Armée vous ordonne quelque chose, vous le faites ! J’ai donc postulé sans imaginer un seul instant que je serais sélectionné. Mais je l’ai été. Et en fait, ça c’est avéré être l’une des années les plus importantes de ma vie et l’une des plus formatrices. Pendant un an, j’ai eu l’opportunité de travailler au sein de la Maison-Blanche, j’ai pu voir le Président Nixon à l’œuvre et rencontrer un grand nombre de gens qui ont eu une influence sur ma vie plus tard.
Lors du Sommet USA-URSS, en 1987 à Washington, comment se sont déroulées les négociations entre Gorbatchev et Reagan ?
D’habitude, les Soviétiques ne souriaient pas, n’étaient pas très raffinés et parlaient grossièrement. Mais là, Gorbatchev portait de très beaux costumes. Je pense que ses cravates étaient françaises… Je ne mentionnerais aucune marque, parce que je ne veux pas avoir d’ennuis avec mes amis français ! Mais il était brillant, il souriait, et il parlait d’ouverture et de restructuration. Vous vous rappelez des mots « Glasnost » et « Perestroïka ».
Nous nous apprêtions à signer le Traité, nous avions donc préparé le Président Reagan pour cette signature. Il était si enthousiasmé par l’idée qu’il nous disait : « Je veux faire comprendre à Gorbatchev que nous voulons être amis, que nous voulons la paix. Nous voulons en finir avec la confrontation nucléaire. Nous voulons la fin de la guerre froide ». Il était excité et se concentrait tellement pour donner une impression positive à Gorbatchev, qu’il avait un peu négligé l’étude des détails du projet. Lors de leur première rencontre, le Président Reagan lui parle de ses rêves, de ses ambitions… et lui offre une paire de boutons de manchette en or, qui représentaient des armes et des objets anciens, des lances, des socs de charrue, mais avec une connotation biblique. Gorbatchev accepte le cadeau, mais le met aussitôt de côté, sans y prêter attention : il veut parler affaires. Nous avions pourtant prévenu le Président : « Nous ne pensons pas qu’il porte des boutons de manchette, mais bon … donnez-les lui ».En fait, la première journée ne s’est pas bien passée. Reagan n’était pas prêt à discuter les détails que Gorbatchev abordait. Vous savez, Reagan, c’était un acteur ! Il avait le sens du théâtre, il comprenait un script. Et lorsqu’il avait le script, qu’il avait un producteur et un metteur en scène, là, il était imbattable. Il était magnifique. Reagan était le symbole du rêve américain, du système de valeurs américaines. Même s’il ne maîtrisait pas toutes les finesses du 3ème degré, il avait une bonne vision, au 1er degré, de ce qu’il voulait accomplir. « Le communisme, c’est mauvais, la démocratie, c’est bien. Nous voulons aider l’Union Soviétique à être différente, meilleure, et nous allons travailler dans ce sens avec vous, même si nous continuons à vous appeler l’Empire du mal », disait-il, ce qui le rendait si unique.
Reagan croyait-il en Gorbatchev lors de l’arrivée de ce dernier au pouvoir ?
Le Président Reagan avait une expression devenue célèbre. Je ne me rappelle pas exactement de ce que cela donnait en Russe, mais c’était un truc du genre « Dovery, proverya », ce qui signifie « Il faut faire confiance, mais vérifier ». On faisait confiance, bien sûr. On n’allait pas regarder un collègue dans les yeux et lui dire : « Je n’ai pas confiance en vous ». Donc Reagan disait – et c’était malin – « J’ai confiance en vous, mais je dois vérifier ce que vous me dites ».
Pouvez-vous revenir sur l’invasion du Koweït en 90…
La nuit de l’invasion, nous avions eu suffisamment d’alertes dans l’après-midi pour prendre ça vraiment au sérieux. Cela allait être une invasion et elle s’est effectivement produite un peu plus tard dans la soirée à l’heure de Washington. Durant les deux jours qui ont suivi, nous avons eu de fréquentes réunions avec le Conseiller de la Sécurité nationale et le Président Bush pour décider des actions à mener. Ma position à ce moment-là était d’examiner les options dont nous disposions, de nous assurer que nous savions dans quoi nous mettions les pieds et d’être sûrs que si nous décidions de nous engager dans ce conflit, nous le fassions correctement. Certaines personnes ont dit que j’étais plutôt réticent les deux premiers jours. C’est vrai. J’ai demandé à mes responsables politiques si le problème était de défendre l’Arabie Saoudite, ce qui était risqué, ou s’il était de stopper l’invasion. Et si tel était le cas, allions-nous nous arrêter là ou bien entreprendre d’autres actions en Irak ?
Pourquoi ne pas avoir renversé Saddam Hussein, et pourquoi vous être arrêtés aux portes de Bagdad ?
La raison est simple : ce n’était pas le but. Cela n’a jamais été un objectif politique. Nous souhaitions juste libérer le Koweït. Les gens ont oublié quelle sorte de coalition était en place à l’époque, quel mandat nous avions des Nations Unies et du Congrès. Le vote fut très serré en faveur d’une intervention, le soutien dont bénéficiait le Président au sein du Congrès étant très faible. L’Armée devait donc se limiter à expulser l’Armée irakienne hors du Koweït. Il n’y a jamais eu de projet d’invasion de l’Irak pour prendre Bagdad et renverser Saddam Hussein. Bien sûr, nous espérions qu’il soit destitué par son propre peuple à cause de son échec. Mais cela ne s’est pas produit.
En 1996, vous avez la possibilité de vous présenter à la Présidence des Etas-Unis d’Amérique…
J’y ai réfléchi pendant un long moment, environ un mois, je n’avais jamais eu d’ambitions politiques auparavant. En tant que soldat de métier, je ne m’étais jamais prononcé en faveur d’un parti et je ne parlais pas de politique. À ce moment-là, j’avais cependant quitté l’Armée et je venais d’écrire un livre qui avait eu un certain retentissement. Plus j’y pensais, plus les gens me poussaient dans cette voie. Finalement, j’ai froidement analysé mes points forts et mes points faibles, j’ai discuté avec ma famille, avec ma femme en particulier, et j’en ai tiré une conclusion qui aurait dû être évidente dès le début : je n’avais pas les gènes d’un politique ! Je suis un soldat.
La décision d’attaquer l’Irak en 2002 était-elle justifiée ?
Nous avons pensé – et j’ai pensé – que c’était justifié, même si par principe, je préfère éviter une guerre. Durant l’été 2002, alors que les préparatifs étaient en cours, que l’on élaborait les plans de la guerre, j’ai dit au Président qu’il fallait porter le problème devant les Nations Unies. J’avais conscience que cela allait être une guerre difficile, si jamais elle avait lieu. Je lui ai donc déclaré : « Vous savez que si nous brisons ce pays en l’envahissant, nous serons responsables, et les conséquences politiques, militaires et économiques seront lourdes. C’est pourquoi nous devons essayer d’éviter la guerre ». Le Président a accepté, et nous avons demandé l’avis des Nations Unies en septembre 2002.
En février 2003, lorsque vous prenez la parole devant la tribune des Nations Unies et que vous justifiez la guerre, en êtes-vous réellement convaincu ?
Cette attaque n’était contestée par aucune des Agences de renseignement. Ces informations n’étaient contestées par aucune des autres Agences de renseignement. Alors, je ne parlerai pas de ce que pensaient les services de Renseignement français… mais les services de Renseignement britanniques et d’autres ne mettaient pas en doute que Saddam Hussein avait l’intention d’avoir de telles armes et qu’il avait la capacité de les fabriquer. Tout le monde en a conclu qu’il possédait ces armes. Il s’est avéré plus tard, après la guerre, lorsque nous avons envahi le pays, qu’en fait, il n’avait aucun stock d’armes de ce genre. Mais l’intention et la capacité de les fabriquer étaient bien réelles. Si les sanctions des Nations Unies avaient été levées et que les inspecteurs de l’ONU s’étaient retirés d’Iraq en disant « OK, on oublie tout cela », qui, parmi nous, oserait croire que Saddam Hussein aurait alors déclaré « D’accord, je ne veux plus d’armes. Je n’en aurais plus jamais ». Au contraire, n’aurait-il pas utilisé cette liberté pour reconstituer ses stocks d’armements ? Le Président Bush, M. Blair, M. Berlusconi, M. Asnar et M. Howard, ainsi que bon nombre d’autres dirigeants, ont alors décidé qu’ils ne pouvaient pas se permettre de prendre ce risque.
Comment considérez-vous la politique ?
La politique est un champ de bataille, car sa réalité correspond à une forme de confrontation entre deux personnalités opposées, entre deux forces qui tentent de gagner. Cette bataille, c’est l’opinion du peuple, des électeurs et dans ce sens, il s’agit bien d’une guerre. Il n’y a évidemment pas de corps jonchant le sol après le combat, mais c’est une guerre malgré tout, une guerre des idées…Voilà ce qu’est la démocratie.
Propos recueillis par
Christian Malard
